Aujourd’hui, presque tout passe par le numérique : rechercher une information, prendre rendez-vous chez un médecin, faire ses démarches administratives, commander en ligne ou encore s’inscrire à une formation. Le numérique est partout, et il structure désormais notre quotidien.
Pourtant, ces usages si simples pour beaucoup ne le sont pas pour tous. Certaines personnes, notamment les personnes handicapées, rencontrent des difficultés majeures pour accéder aux contenus et services en ligne. Imaginez un instant : vous êtes un daltonien et les seules indications de correction des champs de formulaire sont données par les couleurs rouge et vert, qui se trouvent être identiques pour vous, comment faites vous pour savoir quel champ corriger ? Ou encore, vous êtes malentendant et vous regardez une vidéo, quelqu’un parle mais il n’y a pas de sous-titre, comment faites-vous pour avoir accès à ce qu’il est dit et aux informations données ? Ainsi, l’absence d’adaptations adéquates peut transformer ces actions courantes en obstacles insurmontables.
Effectivement, ce n’est pas tant leur handicap qui les empêche d’accéder au numérique, mais bien un environnement numérique mal conçu. Une personne aveugle, par exemple, peut naviguer parfaitement sur un site compatible avec les lecteurs d’écran. Mais si ce site ne propose pas de descriptions alternatives pour les images ou si sa structure est désorganisée, alors elle se retrouve en situation de handicap numérique.
Autrement dit, ce n’est pas la déficience qui crée la difficulté, mais l’inaccessibilité du support. Ce phénomène touche une diversité de profils : des personnes atteintes de déficiences sensorielles (visuelles ou auditives), de troubles cognitifs, de limitations motrices. Cela concerne aussi les personnes non-handicapés qui, dans certains contextes, par exemple sans souris, se retrouvent eux aussi temporairement en situation de handicap.
Face à ces enjeux, l’accessibilité numérique s’est imposée comme une nécessité sociale et technique. Elle vise à faire en sorte que les services en ligne soient utilisables par tous, sans exclusion.
C’est dans ce contexte que le RGAA, ou Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité, a été créé en 2009.
Le RGAA : une réglementation pour une meilleure accessibilité numérique
Le RGAA : un cadre pour une accessibilité en ligne pour toutes et à tous
En France, l’accessibilité numérique est encadrée par le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA), un cadre réglementaire mis en place pour garantir que les services numériques soient accessibles à tous les utilisateurs, quels que soient leurs capacités physiques, sensorielles, cognitives ou matérielles.
En s’appuyant sur les recommandations internationales du WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), le RGAA reprend les grands principes tout en les adaptant aux exigences juridiques et techniques françaises. Il s’applique aux sites internet, applications mobiles, intranets, mais aussi aux documents numériques comme les PDF, les vidéos ou encore les formulaires.
L’objectif est clair : rendre l’ensemble des contenus et services numériques utilisables en toute autonomie, même pour des personnes qui ne peuvent pas utiliser une souris, voir une image ou entendre une vidéo. Une personne déficiente visuelle pourra ainsi naviguer via un lecteur d’écran, une personne malentendante accéder à des sous-titres, et une personne atteinte de troubles moteurs se déplacer uniquement au clavier.
La cible du RGAA : les personnes en situation de handicap
Le RGAA vise avant tout à rendre le web accessible aux personnes handicapées. Cela comprend les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes, à mobilité réduite, ayant des troubles cognitifs ou sujettes à l’épilepsie. Grâce à des outils comme les lecteurs d’écran, les afficheurs braille ou les dispositifs de navigation au clavier, ces personnes peuvent utiliser les services numériques, à condition que ceux-ci soient conçus de manière accessible.
Toutefois, il vise de façon plus large les personnes en situation de handicap. Il faut bien distinguer les personnes handicapées des personnes en situation de handicap. Une personne peut avoir un handicap sans pour autant rencontrer de difficultés, si le service numérique est bien conçu. Le RGAA agit donc pour faire en sorte que le handicap ne se transforme pas en exclusion. Et inversement, une personne non-handicapé mais qui n’a pas de souris, par exemple, et seulement un clavier peut se retrouver en situation de handicap.
Norme d’accessibilité numérique : une nécessité encore trop peu respectée
“Au total, en France (métropole et DROM), le nombre d’enfants et d’adultes handicapés (de 5 ans ou plus), qu’ils vivent à domicile ou en établissement, varie de 5,7 millions à 18,2 millions de personnes selon la définition utilisée.” Et pourtant, seulement 3,5 % des sites contrôlés respectent leurs obligations d’accessibilité, et à peine 0,37 % déclarent une conformité totale au RGAA (source : Observatoire du respect des obligations d’accessibilité numérique).
Un référentiel structuré et exigeant
Pour répondre à cet enjeu, le RGAA propose un ensemble structuré de 106 critères techniques répartis en 13 grandes thématiques : images, couleurs, navigation, formulaires, etc. Chaque critère est associé à un ou plusieurs tests de conformité précis, soit environ 265 tests au total, permettant d’évaluer le niveau réel d’accessibilité d’un service numérique.
Pour évaluer votre conformité au RGAA, un audit d’accessibilité numérique est nécessaire à partir des ces critères . Il permet d’identifier les points de conformité et les axes d’amélioration de votre site.
Trois niveaux sont ensuite établis selon les résultats obtenus :
- Conformité totale : tous les critères applicables sont respectés.
- Conformité partielle : plus de 50 % des critères applicables sont respectés.
- Non-conformité : moins de 50 % des critères sont respectés, ou aucun audit valide n’est disponible.
En harmonisant les pratiques et en imposant des exigences concrètes, le RGAA permet aux acteurs publics, et aux acteurs privés, de proposer des services véritablement accessibles, et donc de contribuer à une société plus inclusive.
Quels types de contenus sont concernés ?
Le RGAA s’applique à aux contenus et services en ligne : sites internet, intranets, extranets, applications mobiles, documents PDF, etc. Il vise à garantir que ces supports soient perceptibles (ex. : bon contraste, alternatives textuelles), utilisables (navigation clavier), compréhensibles (interface claire) et robustes (compatibles avec les technologies d’assistance).
Qui est concerné par le RGAA ?
Le RGAA ne s’adresse pas uniquement aux administrations publiques. En réalité, la loi impose à un large éventail d’organismes de se conformer aux règles d’accessibilité numérique. Cela inclut les services de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, mais aussi les acteurs privés investis d’une mission de service public, comme les concessionnaires de transports ou les délégataires de réseaux. Ces obligations portent sur l’ensemble des supports numériques proposés par ces structures.
Par ailleurs, le champ d’application du RGAA s’étend progressivement. Depuis peu, les plateformes de commerce en ligne doivent également se mettre en conformité. Pour comprendre ce qu’implique « être conforme », découvrez notre article « Comment se rendre conforme RGAA ?« .
Une exigence légale assortie de sanctions
Depuis plusieurs années, l’accessibilité numérique n’est plus seulement une bonne pratique : elle est devenue une obligation légale. En cas de manquement, les structures concernées peuvent faire l’objet de sanctions administratives, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 €, renouvelables tous les six mois en l’absence de mise en conformité, notamment si la déclaration d’accessibilité ou le schéma pluriannuel n’ont pas été publiés.
Sensibiliser avant de sanctionner
Le respect de ces obligations est surveillé par plusieurs instances, comme la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), qui veille notamment à l’accessibilité des sites e-commerce, ou encore l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), compétente sur les plateformes audiovisuelles.
Dans un premier temps, ces organismes ont pour mission de sensibiliser et d’accompagner les acteurs concernés, en leur laissant l’opportunité de corriger les écarts avant d’éventuelles sanctions.
Le RGAA : un levier pour l’accessibilité numérique
Le RGAA est plus qu’un simple référentiel technique : c’est un levier essentiel pour garantir l’égalité d’accès au numérique pour toutes et tous. En rendant les services en ligne accessibles, il permet de réduire les inégalités, d’offrir plus d’autonomie et de participation à toutes les personnes, qu’elles soient en situation de handicap ou simplement confrontées à des contraintes techniques.
Respecter le RGAA, c’est faire un pas concret vers un web inclusif et respectueux des droits de chacun.
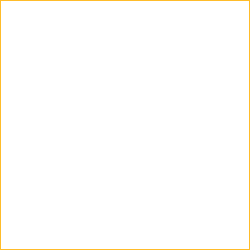
Chez Netsulting, nous vous accompagnons à chaque étape : sensibilisation, audit de conformité, conseils et mise en accessibilité de vos supports numériques.
